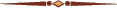Gustave Doré – Appendice : Note sur la gravure
en fac-similé
Nous reproduisons ici un article qui a paru dans le journal L’Estampe, et qui explique d’une façon très nette cette fameuse question de la gravure sur bois. Cet article n’était pas signé ; il nous semble cependant y reconnaître la plume d’un graveur habile, que nous pourrions nommer, et qui est un juge très sûr en cette matière.
Un fait indiscutable est que la gravure sur bois en Allemagne et en Angleterre a conservé une unité de physionomie qu’elle a perdue chez nous. Cela ne veut pas dire que, dans ces pays, une seule manière de comprendre la gravure y soit pratiquée ; mais en restant fidèle au caractère propre, nous pourrions dire naturel à la gravure sur bois, et en en conservant la vieille tradition tout en lui faisant subir les modifications résultant des évolutions des arts modernes, la production des « bois », chez nos voisins a un ensemble et une saveur qui nous font aujourd’hui défaut.
Pour reconnaître en quoi nous différons des Allemands et des Anglais dans notre gravure, il faut que nous examinions quels sont le rôle fondamental et la raison d’être de la gravure sur bois.
La gravure sur bois a pour mission l’accompagnement, l’ornementation , ou comme l’on dit aujourd’hui où tout est tourné vers le décoratif, la décoration du texte typographique.
Pour résumer toutes ces épithètes par un terme appartenant à la gravure sur bois, — quoiqu’il ne nous paraisse pas très juste, — la gravure sur bois sert à illustrer les livres. Aussi, comme le caractère typographique, la gravure sur bois, qui doit marcher de pair avec lui, est-elle en relief, et c’est cet accouplement qui est la raison de la gravure sur bois.
Sans lui, elle ne serait qu’une curiosité d’art. Il découle de là, pour elle, des exigences d’harmonie, de liaison avec le caractère typographique qui, si elles sont oubliées, font, de ce mélange du texte et du dessin, des œuvres disparates.
Ces nécessités, qui n’ont d’autres règles que celles qui dérivent du goût (le goût est peut-être une science), furent fidèlement remplies tant que la gravure sur bois fut émise en fac-similé ; pour les besoins de notre cause nous dirons : tant que la gravure sur bois suivit la formule du trait. Dans cette formule, toutes les teintes sont exprimées par des traits qui laissent entre eux des blancs, et ces blancs, nous pouvons les comparer à l’œil du caractère typographique. D’où résultent l’harmonie d’effet, l’accord de couleurs, si on peut dire, entre le texte et le dessin gravé.
En énonçant ce principe de gravure, il semblerait que le graveur peut remplacer le talent par l’exactitude, le scrupule qu’il apporte à suivre les traits du dessin qu’il veut conserver sur son bois ; mais il ne faut pas oublier qu’un trait peut être interprété de cent façons différentes et que, pour choisir la bonne, l’unique, il faut l’initiative la plus délicate. Nous croyons qu’une gravure en fac-similé est encore l’œuvre la plus rare à rencontrer parfaite.
Je ne pense pas que l’on puisse contester que ce ne soit là le véritable type de la gravure sur bois, ainsi que le rôle qu’elle doit remplir. Elle n’y avait pas manqué depuis son origine jusqu’aux vignettes de Gigoux et de Tony Johannot.
Mais, pour que le graveur puisse exécuter un bois dans cette donnée traditionnelle, il est indispensable que le dessinateur s’astreigne tout d’abord à faire un dessin particulier, dont toutes les parties soient formellement exprimées par des traits, sans lavis ni estompage. Et c’est ici que nous différons des Allemands et des Anglais.
Tandis qu’ils ont continué à pratiquer cette tradition, nous l’abandonnons presque complètement et nous la remplaçons par une autre formule de dessin que nous appellerons : la formule des teintes. Ici le dessinateur n’a plus rien à observer en vue de la gravure.
Il se sert du lavis, de l’estompe. Tous les moyens sont bons. Avec cette formule des teintes, la gravure sur bois aborde l’imitation de tous les genres de gravure et même de la lithographie ; mais alors ce qu’elle ne fait plus, c’est de la gravure sur bois proprement dite.
Pour que les dessinateurs pussent adopter cette formule des teintes, il fallait que, par leur talent, les graveurs fussent en état d’y répondre, car, dans ce genre de gravure, l’interprétation est complète. Le sens des tailles n’est pas ou n’est que très peu indiqué. Tout est laissé à l’initiative du graveur.
C’est ce compromis qui aboutit à l’imitation de tous les genres de gravure et sur lequel nous vivons depuis déjà un temps assez long, qui, marquant la véritable physionomie de la gravure sur bois, fait produire ces œuvres dont le seul défaut, mais il est capital, est de dissimuler le moyen par lequel elles sont produites.
Mais le talent de nos graveurs s’est encore affirmé dans cette occurrence en luttant souvent avec succès contre la fausseté de la situation qui leur est faite.
C’est ainsi qu’ils nous obligent à tenir compte, par le mérite qu’ils apportent dans leurs travaux, d’oeuvres qui ne sont ni chair, ni poisson.
Ce sont les dessinateurs qui ont méconnu le principe de la gravure sur bois et les éditeurs qui ont encouragé et propagé cette déviation d’un art dont le rôle est d’une clarté si absolue et d’un intérêt si grand. Les graveurs sont hors de cause, quoiqu’ils aient concouru à l’exécution d’œuvres qui n’étaient pas positivement de leur domaine, mais le talent et l’initiative qu’ils y ont prodigués les met en dehors de l’enquête.
Pour nous résumer :
Le talent individuel du graveur sur bois s’est élevé en France, puisqu’il a abordé de front l’interprétation absolue du dessin qu’on lui confiait, pendant que la production générale de la gravure sur bois française perdait en unité et en valeur par l’oubli de l’essence propre à cette gravure.
Pour nous, si nous avions à faire illustrer un livre au moyen de bois, nous n’admettrions que des bois gravés en fac-similé, c’est-à-dire suivant la formule du trait.
Les graveurs sur bois peuvent cependant faire observer avec raison que l’unité de physionomie qu’on veut conserver ressemble beaucoup à la monotonie ; qu’il est dans l’essence de toutes choses de se transformer ; qu’ils gravent ce qu’on leur donne à graver, du trait ou du lavis : que l’affaire regarde donc les dessinateurs ; — que les conditions de la gravure sur bois se sont bien modifiées depuis Gigoux et Johannot ; qu’on ne l’emploie plus seulement à l’illustration des livres, mais qu’on lui demande encore toutes les reproductions nécessaires aux journaux illustrés, pour lesquelles on leur fournit des photographies, ou des dessins faits au galop, le tout devant être interprété à court délai ; que dans ces conditions ils sont arrivés à un degré d’habileté extraordinaire. Ce qui est vrai. Il y a dans les ouvrages de Doré des gravures d’interprétation qui sont des tours de force, notamment celles obtenues par un rang de tailles blanches poussées d’un bord à l’autre de la planche. Ce sont les Mellan de la gravure sur bois. On sait qu’au dix-septième siècle, Mellan avait imaginé de graver sans jamais croiser ses tailles : au besoin il vous faisait une tête de Christ avec une seule taille partant du bout du nez et se développant en spirale. Ce sont là de ces curiosités qui vous étonnent d’abord, puis vous fatiguent autant que si l’on voyait un homme se complaire à ne marcher que sur un seul pied.
Quand les burinistes poussent systématiquement de belles tailles bien régulières, il y a des gens qui les qualifient du nom malhonnête de chaudronniers ; ne peut-on pas dire, alors, que la gravure sur bois dont nous parlons tourne à la menuiserie ?
Cet article a été établi à partir de l’ouvrage de Henri Beraldi Les graveurs du XIXe siècle, Paris, 1885-1891. Le texte original est disponible sur Gallica en mode image.